PIERRES A CUPULES
ET ROCHES GRAVEES EN SAVOIE

C’est au cours de la
seconde moitié du 19° siècle que l’attention des chercheurs a été
attirée par les manifestations humaines graphiques ou picturales dans
des grottes ou sur des rochers de plein air.
En Savoie les premières observations et publications on eu pour objet
les pierres à cupules et à bassins facilement repérables étant donné la
profondeur de leurs « sculptures » comme l’on disait parfois à
l’époque. C’est ainsi que dès 1878 Louis Revon donnait un inventaire
presque complet des pierres à cupules de la Haute-Savoie et que
Florimond Truchet en décrivait un certain nombre d’autres en Maurienne.
Il faudra attendre le grand élan archéologique de la première décennie
du 20° siècle, et notamment le congrès préhistorique de France à
Chambéry en 1908 pour avoir un gros complément d’informations.
Les figurations de pieds et de mains.
Les « pierres aux pieds » qui semblent être l’apanage de la Maurienne y
sont abondantes car elles se retrouvent dans la plupart des sites
importants de haute altitude depuis St Michel de Maurienne jusqu’à
Bessans, à l’exception de la zone interne du PNV. Il n’en va pas de
même pour les figurations de mains qui sont beaucoup plus rares (8
exemplaires inventoriés contre près de 250 pour les pieds).
En général groupées sur un seul rocher par site, les figurations de
pieds se présentent sous trois factures différentes : profondément
piquetées en creux jusqu’à une profondeur pouvant atteindre 25mm,
simplement piquetées à fleur de rocher sans profondeur mesurable, ou
tracées au contour comme les autres gravures. Les pieds sont
représentés isolés, pied gauche ou pied droit ou par paires. De taille
moyenne beaucoup plus petite que celle du pied d’un adulte de l’époque
actuelle, elles présentent certaines particularités dans leur style.
C’est ainsi que les paires de pieds en creux sont souvent accompagnées
d’une cupule ou d’une barrette au milieu ou à la partie antérieure des
pieds. Les pieds au contour sont parfois ornés d’une sangle marquant le
talon. Certaines paires de pieds au contour peuvent même être accolées.
Une importante remarque est à faire sur l’association des pieds et des
cupules : les pieds en creux sont toujours accompagnés de grosses
cupules alors qu’il en est très rarement ainsi pour les pieds à fleur
de rocher ou au contour. Cette association est particulièrement visible
sur les deux plus grandes pierres aux pieds de la vallée : la pierre du
Pertuit, au Thyl, avec ses 62 pieds dont 12 paires, 160 cupules et 2
bassins, et la pierre aux pieds de Pisselerand à Lanslevillard, qui
présente 82 pieds dont 35 paires et plus de 80 cupules. Cela amène à
penser que ces deux pierres sont contemporaines des grandes pierres à
cupules, d’autant plus que leur situation est identique : position
dominante et paysage très dégagé.
Ces empreintes profondes de longueur comprise entre 16 et 26 cm avec
une très forte moyenne de 23 cm, pour autant qu’elles correspondent à
un échantillonnage de la population, laisseraient supposer la présence
d’une race de petite taille, telle que celle apparue au Néolithique
dans le massif alpin. S’il ne s’agit que d’empreintes de pieds
d’enfants ou d’adolescents, la présence d’une race de taille comparable
à celle que nous connaissons actuellement prévaudrait, avec, comme
hypothèse, l’utilisation de ces rochers comme lieux de cérémonies
initiatiques et de rassemblement cultuel.
L’orientation globale vers l’est des pieds de la pierre aux pieds de
Lanslevillard a conduit certains auteurs à voir là les traces d’un
culte du soleil levant. Un récent examen statistique de l’orientation
de l’ensemble des empreintes de pieds semble devoir attribuer ces
manifestations à un culte, au sens large du terme, des sommets et des
glaciers visant à obtenir leur protection ou leu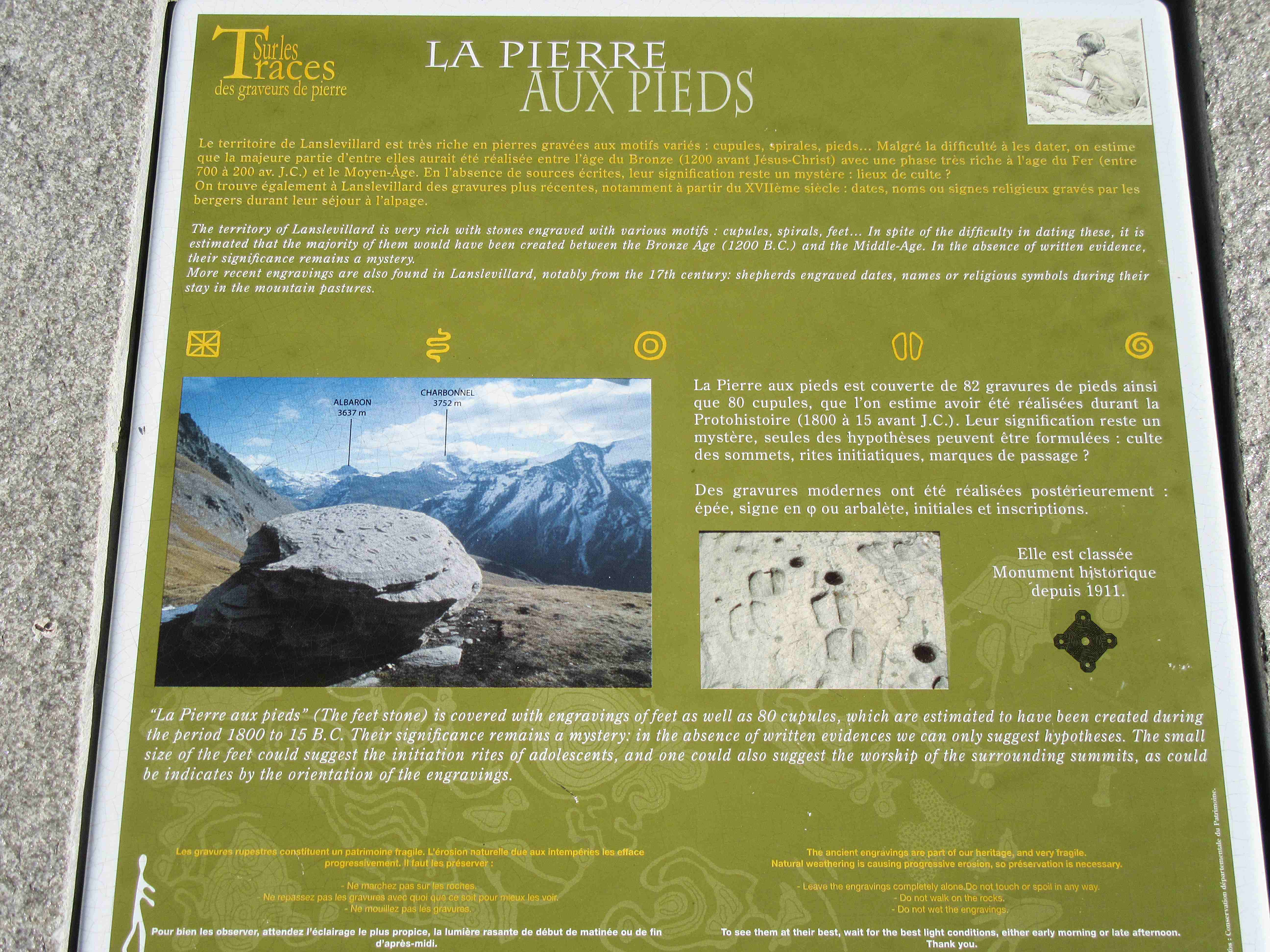 r clémence. Ce pourrait
être un des aspects du culte de la nature qui apparaît dans les
concepts spirituels des populations protohistoriques, notamment à l’Age
du Fer. Mais un certain nombre d’observations concernant des pieds au
contour tracés en association directe avec des noms des prénoms ou des
dates permettent de dire que cette tradition a perduré jusqu’à la fin
du 18° siècle.
r clémence. Ce pourrait
être un des aspects du culte de la nature qui apparaît dans les
concepts spirituels des populations protohistoriques, notamment à l’Age
du Fer. Mais un certain nombre d’observations concernant des pieds au
contour tracés en association directe avec des noms des prénoms ou des
dates permettent de dire que cette tradition a perduré jusqu’à la fin
du 18° siècle.
Les figurations humaines.
Localisées dans un seul site au-dessus de Lanslevillard, ces
figurations humaines de grande taille, 1.20 m à 1.50 m de long sont
accompagnées de gravures schématiques comportant surtout des marelles
et des rouelles. La suite commence au dessus des chalets de
l’Arcelle-Neuve, pour se terminer à la base des éboulis issus du signal
du Grand Mont Cenis. Sept dalles comportent de telles gravures.
Les figurations d’outils.
Des figurations d’outils n’ont été trouvées que sur une seule dalle, la
pierre de Linchaplour à proximité du village de Lanslevillard, en
association avec un ensemble de gravures schématiques. Exécutées en
piquetage différend de celui de ces dernières, elles semblent avoir été
tracées postérieurement. On peut y reconnaître un groupe de deux
doloires, outils de charpentier, et un autre groupe d’outils
métalliques allongés accompagnés d’un soufflet évoquant le métier de
forgeron. Cette dalle est d’ailleurs un bon exemple des thèmes du
serpent et des méandriformes, composition dans laquelle sont imbriquées
des figurations de pieds piquetées à fleur.
Les gravures utilitaires.
Il faut enfin signaler les gravures utilitaires qui sont de deux sortes
dans cet ensemble de gravures schématiques : les traits isolés ou
groupés parallèlement par deux ou trois, appelés « onches », qui
marquent les limites cadastrales de parcelles dans certaines communes
de Maurienne, et les classiques triangles géodésiques avec point
central présents un peu partout à la suite des nombreux travaux de
captage des eaux effectués par EDF dans les massifs montagneux.
Les problèmes de datation.
La datation d’un art schématique de plein air se heurte à deux
difficultés principales : l’impossibilité d’appliquer une méthode
stratigraphique, et d’autre part l’absence dans cette décoration de la
représentation d’objets typiques, armes poignards etc. Il existe
d’autres méthodes de datation qui n’offrent pas une garantie absolue et
qu’il est préférable de combiner entre elles.
>
Résumé très brièvement le contexte archéologique de cette région est le
suivant : si les vestiges du néolithique sont absents de cette haute
vallée les périodes du néolithique final-chalcolithique et du bronze
ancien sont présentes. Le bronze final est très abondant en aval
d’Aussois, alors qu’il est totalement absent du basin de Lanslevillard.
Ce schéma de datation assez simple et cohérent mais n’offrant pas
toutes garantie d’exactitude est malheureusement profondément perturbé
par le fait que certaines de ces gravures ont continué à être tracées
par tradition pendant des centaines d’années, et ce pratiquement
jusqu’à la fin du 18° siècle malgré la christianisation et malgré les
interdits de l’Eglise. Mais peut-être n’avaient elles pas alors la même
signification qu’à l’origine. Cette dernière réflexion nous conduit à
évoquer les difficultés rencontrées également dans le domaine de la
signification de ces gravures schématiques.
Les problèmes de signification.
> Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts
spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il
est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques
siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont
surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des
sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces
populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques
concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes
ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et
rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et
parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner
à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la
signification des gravures.
Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts
spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il
est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques
siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont
surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des
sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces
populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques
concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes
ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et
rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et
parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner
à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la
signification des gravures.
On perçoit d’ailleurs nettement dans les différents sites que, dès la
fin du18° siècle la vague de nouvelles idées philosophiques sonne le
glas de cette symbolique schématique de tradition orale, car seuls sont
alors tracés des patronymes, des dates et des croix latines. Un silence
de deux cents ans a mis fin à la transmission du message et il faut
bien reconnaître que nous ne sommes plus aujourd’hui des initiés.
Texte composé de larges parties extraites d’un petit ouvrage intitulé , édité par la Société Savoisienne d’Histoire et
d’Archéologie, Square de Lannoy de Bissy à Chambéry.
Gérant-responsable de la revue : Christian Sorrel.
Jean-Pierre Baudat
Photos
de la sortie
| Retour
: Echos de nos sorties
|
Retour
accueil

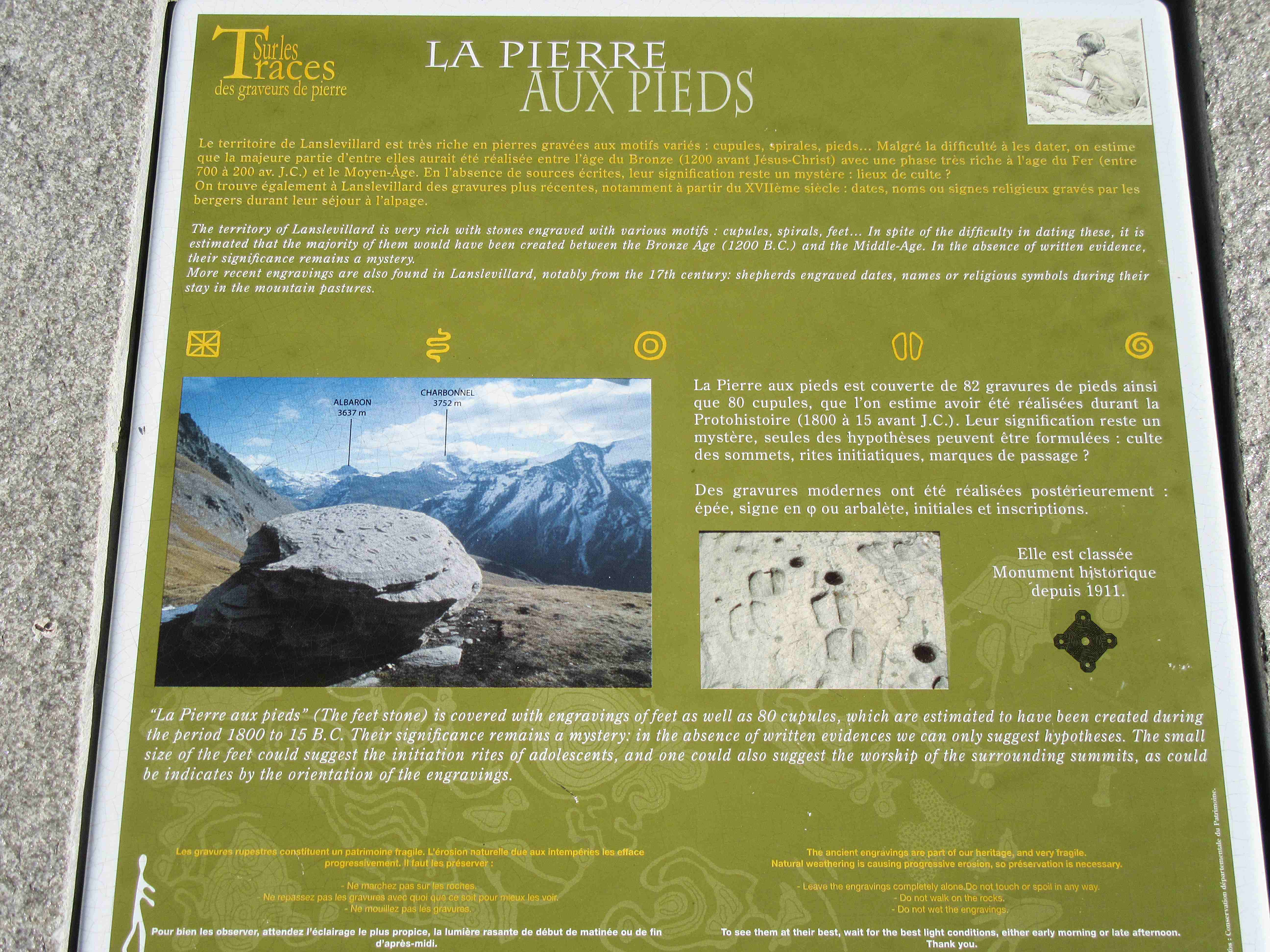
 Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts
spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il
est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques
siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont
surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des
sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces
populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques
concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes
ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et
rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et
parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner
à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la
signification des gravures.
Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts
spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il
est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques
siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont
surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des
sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces
populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques
concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes
ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et
rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et
parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner
à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la
signification des gravures.